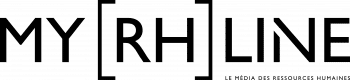La Semaine de la QVCT 2025 vient de s’achever. Si ces temps forts contribuent à sensibiliser aux enjeux du bien-être au travail, ils révèlent aussi une réalité contrastée : dans de nombreuses entreprises, la QVCT reste encore associée à des initiatives ponctuelles, parfois déconnectées des priorités structurelles. Alors, comment inscrire la QVCT dans une politique RH cohérente, durable et porteuse de transformation ?
Dynamique durable ou simple coup de com : où en est la QVCT ?
Chaque été depuis 2022, un pic de recherches sur les moteurs de recherche autour de la QVT témoigne d’un intérêt récurrent. Mais au-delà de la tendance numérique, la réalité terrain confirme cette attente : pour 91 % des salariés, la qualité de vie et des conditions de travail constitue un enjeu important, voire prioritaire.
Trois dimensions concentrent particulièrement leur attention :
- le sentiment de sécurité, physique et psychologique ;
- la qualité des relations de travail ;
- l’organisation des missions et du temps.
Dans ce contexte, les initiatives ponctuelles ne suffisent plus. Les collaborateurs attendent des entreprises une approche plus ancrée, qui dépasse les effets d’annonce. Pourtant, dans les faits, les démarches restent encore souvent morcelées, portées par des actions isolées sans vision d’ensemble. Cette multiplication d’actions doit laisser place à une stratégie en phase avec les enjeux réels de l’entreprise.
Repenser le cadre, pas seulement les actions
Premier constat : la QVCT, abordée comme un simple catalogue de bonnes pratiques, est vouée à l’essoufflement. Ce qui fait la différence aujourd’hui, c’est la capacité à inscrire ces actions dans une dynamique cohérente. Cela suppose un regard critique sur les pratiques existantes et une volonté de les faire évoluer. Quelques questions-clés peuvent guider cette réflexion :
- À quel besoin cette action répond-elle ?
- S’inscrit-elle dans une stratégie plus large ?
- Quelle est sa priorité par rapport aux enjeux internes ?
Il ne s’agit pas d’en faire plus, mais de mieux faire. Et surtout, de faire avec sens.
Une approche holistique du bien-être
Pour porter ses fruits, la QVCT doit intégrer toutes les dimensions du quotidien professionnel :
- Physique : conditions matérielles, ergonomie, sécurité ;
- Émotionnel : gestion des tensions, qualité des relations ;
- Social : sentiment d’appartenance, lien aux autres ;
- Financier : rémunération équitable, avantages alignés ;
- Professionnel : autonomie, perspectives, reconnaissance ;
- Communautaire : contribution à un projet collectif, ancrage sociétal ;
- Utilité perçue : sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand.
Ce prisme global permet d’éviter les angles morts. Car une action bien pensée dans un domaine (comme la santé mentale) peut perdre son impact si elle ignore d’autres leviers essentiels (rémunération, charge de travail, reconnaissance…).
Construire une dynamique dans la durée
La légitimité d’une démarche repose sur sa constance. Si la QVCT ne vit que lors de la Semaine dédiée, elle perd toute crédibilité. Loin des effets d’annonce, elle gagne à s’incarner dans les pratiques quotidiennes, les choix organisationnels et surtout, les postures managériales.
Cela implique aussi d’instaurer une logique d’écoute et d’ajustement. Enquêtes internes, indicateurs qualitatifs, audits : autant d’outils pour affiner les dispositifs sans les figer. En intégrant les retours terrain dans la boucle, la fonction RH peut renforcer l’engagement autour de la démarche.
Et lorsque les collaborateurs sont associés à la définition des priorités, les dispositifs gagnent en pertinence et en adhésion. Co-construire permet non seulement de mieux répondre aux attentes, mais aussi de favoriser l’appropriation des actions.
Une démarche concrète, durable et systémique de QVT : l’exemple de France Télévisions
Certaines entreprises parviennent à structurer une démarche QVT réellement intégrée et durable. C’est le cas de France Télévisions, engagée depuis 2017 dans une politique articulée autour de l’équilibre des temps de vie.
Parmi les leviers mis en œuvre : une conciergerie digitale, un accompagnement spécifique des salariés aidants, un dispositif de cohabitation intergénérationnelle, et une série d’actions pour prévenir l’hyperconnexion, dont un jeu pédagogique sur les usages numériques.
L’intérêt de cette démarche réside dans sa continuité et sa capacité d’adaptation. Durant la crise sanitaire, l’entreprise a renforcé ses pratiques existantes et les managers ont également été formés à prendre en compte la réalité personnelle de leurs équipes.
Cette expérience montre qu’une démarche QVCT efficace ne repose pas sur une succession d’initiatives. Mais sur un cadre structurant, nourri d’un dialogue entre acteurs RH, managers et collaborateurs. C’est cette dynamique qui garantit la cohérence et la légitimité des actions dans le temps.
Cap sur la Semaine de la QVCT 2026
Aujourd’hui, la QVCT n’est plus une option. Elle devient un marqueur de crédibilité et de maturité RH. Mais pour tenir cette promesse, elle doit sortir de la logique événementielle et engager une démarche, parfois imparfaite, mais pour autant cohérente.
En 2026, les RH seront attendues sur leur capacité à structurer un cadre clair, aligné avec les réalités du terrain. C’est dans cet équilibre que se jouera la réussite des politiques de qualité de vie au travail : non comme une obligation, mais comme une opportunité de (re)donner du sens au travail.