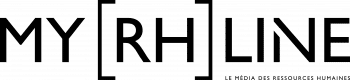Les entreprises n’ont jamais été confrontées à une telle diversité générationnelle au sein de leurs équipes : Baby-boomers, Génération X, Millennials et Génération Z se côtoient, avec des attentes, des valeurs et des modes de travail différents. 92 % des salariés travaillent aujourd’hui dans une équipe multigénérationnelle. Et la majorité y voit un facteur d’enrichissement.
Pourtant, certaines incompréhensions subsistent, le fameux « conflit des générations », alimenté par des clichés plutôt que des oppositions réelles. Encore faut-il en prendre conscience, et agir. Hackathon intergénérationnel, comité spécial, legs de compétences… Voici cinq pratiques pour tirer parti de cette mixité des âges.
N°1 Recruter sans biais, pour ne pas reproduire les exclusions
La diversité générationnelle commence dès le recrutement. Trop souvent, les canaux utilisés, la rédaction des offres ou les méthodes d’évaluation peuvent induire des discriminations, en particulier à l’encontre des profils plus expérimentés. Pour favoriser une démarche inclusive, charge aux recruteurs de :
- Varier les canaux de diffusion, pour s’adresser aussi bien aux jeunes diplômés qu’aux seniors en reconversion ou en mobilité.
- Mettre en place des dispositifs d’objectivation, via des tests techniques ou des études de cas, afin de juger le savoir-faire plutôt que le CV.
- Se former à l’inclusion, y compris sur le volet générationnel, pour limiter les biais, souvent inconscients, dans le processus de sélection.
Certaines entreprises vont plus loin en intégrant des objectifs de diversité intergénérationnelle dans leur politique RSE, à l’instar de ce qui existe déjà sur la parité ou l’inclusion du handicap.
N°2 Manager dans l’écoute et la coopération : l’exemple du conseil des générations
Dans un environnement multigénérationnel, le rôle du management est clé pour transformer la diversité des profils en complémentarité. Cela suppose d’adapter son style de leadership et de créer des espaces de dialogue entre les générations, au risque, sinon, de creuser l’écart entre collaborateurs.
Pour favoriser cette coopération intergénérationnelle, certaines organisations mettent en place un « conseil des générations », réunissant des représentants de chaque tranche d’âge pour identifier ensemble des pistes d’amélioration. Ce type de groupe de travail, orchestré par les RH, favorise l’expression des attentes et permet de poser des actions tangibles.
D’autre part, c’est un excellent moyen de détecter des signaux faibles et ainsi, d’anticiper d’éventuels malentendus ou le retrait de certains collaborateurs en décalage avec les méthodes managériales. En donnant à chaque génération un rôle actif, on renforce leur engagement… et on fait tomber les stéréotypes.
N°3 Assurer la transmission autrement : l’exemple du legs de compétences
Favoriser la transmission des savoirs entre générations est souvent vu sous l’angle du mentorat, du compagnonnage ou du tutorat inversé. Des formats utiles, qui font leur preuve, mais parfois trop centrés sur des logiques descendantes ou informelles. Pour aller plus loin, certaines structures expérimentent des approches plus structurées.
C’est le cas de la préfecture de Normandie et du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR). Ces derniers ont lancé en 2021 un dispositif innovant de « legs de compétences ». Destiné aux agents en fin de carrière, ce programme vise à capitaliser leurs expertises tout en préparant leur transition professionnelle. Il repose sur trois ateliers collectifs d’une journée, réunissant de 4 à 6 volontaires qui quitteront leurs fonctions dans un délai de 6 mois à 3 ans.
Les objectifs sont multiples :
- Amorcer un bilan professionnel pour identifier les contours du legs ;
- Se positionner face aux compétences transférables ;
- Bâtir son propre plan de transfert de compétences et son plan d’actions de maintien et/ou de transition professionnels.
Ce dispositif va au-delà d’un simple transfert de savoir technique. Il permet de préserver le patrimoine professionnel du service, de reconnaître la valeur de l’expérience, et de sécuriser la continuité opérationnelle. Un modèle inspirant, transposable dans d’autres environnements, notamment privés, où la fuite des savoirs liée aux départs à la retraite est une préoccupation croissante.
- Cet article pourrait aussi vous intéresser : Emploi des seniors et dialogue social, ce que contient le projet de loi du 8 juillet 2025
N°4 Adapter la QVCT à chaque étape de la vie professionnelle
Les enjeux de santé et de qualité de vie au travail ne sont pas les mêmes à 25 ou à 60 ans. Pour garantir un cadre de travail réellement inclusif, les entreprises doivent ajuster leurs politiques. Et ce, en fonction des besoins physiologiques, cognitifs ou psychosociaux propres à chaque âge.
Dans les métiers physiques, cela peut passer par une prévention renforcée pour les salariés les plus exposés. Certaines initiatives comme en Finlande – où l’État soutient le maintien en emploi des seniors par des mesures ergonomiques ou de reconversion douce – montrent l’efficacité de ces approches différenciées.
À l’inverse, les plus jeunes attendent davantage de flexibilité, d’accompagnement dans leur montée en compétences et d’opportunités de sens. La QVCT multigénérationnelle passe aussi par là : éviter les solutions uniformes, au profit d’un accompagnement personnalisé.
N°5 Favoriser une communication qui parle à tous : l’exemple du hackathon intergénérationnel
Les différences générationnelles ne se résument pas aux outils, mais aussi aux styles de communication.
- Les Baby-Boomers et la Génération X privilégient encore largement les réunions en présentiel (64 %). Contre 45 % des Millennials et seulement 25 % des Z.
- Les plus jeunes sont sensibles à une culture d’équipe où l’humour est toléré, tandis que leurs aînés ont été habitués à une communication plus formelle.
Ces différences ne doivent pas être vues comme des freins. Mais plutôt comme des clés pour mieux adapter les dispositifs de communication interne. Une culture d’entreprise inclusive intègre différents formats : email, messagerie instantanée, rituels d’équipe… et veille à créer des ponts entre styles de communication.
Des initiatives créatives peuvent aussi favoriser le dialogue, comme les hackathons intergénérationnels. Ces défis, concentrés sur un temps court, obligent les participants à coopérer rapidement pour atteindre un objectif partagé.
En mettant les générations en situation de collaboration directe, ils bousculent les idées reçues et renforcent la compréhension mutuelle. Mais attention : sans cadrage clair, ce genre d’exercice peut aussi cristalliser des tensions latentes.
Pour une gestion du multigénérationnel plus efficace
Tirer parti du multigénérationnel suppose d’éviter le piège du générationalisme. Cette tendance à réduire les comportements à l’âge ou à l’appartenance à une génération. Or, les générations ne sont pas des blocs homogènes, mais des constructions sociales, influencées par des contextes variés.
En entreprise, l’enjeu n’est donc pas de catégoriser, mais de créer des passerelles. Miser sur l’échange, la reconnaissance mutuelle et la souplesse managériale permet de dépasser les stéréotypes. Car les vraies fractures naissent rarement de l’âge, mais de l’absence de lien et d’écoute.
Pour aller plus loin sur cette idée et déconstruire les clichés qui alimentent les tensions générationnelles, retrouvez le replay de notre rencontre avec Frédérique Jeske, auteure du livre Le choc des générations n’existe pas.
Source(s) documentaire(s) :
- Mix des générations au travail, rapport Atlassian
- Legs de compétences entre agents publics normands