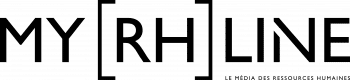Ce 24 septembre, les Trophées des Femmes de l’Industrie, soutenus par l’association Femmes Ingénieures, récompenseront des carrières féminines exemplaires dans tous les secteurs industriels.
Une nouvelle occasion pour valoriser notamment les femmes ingénieures qui continuent de manquer continuellement à l’appel.
Malgré de multiples initiatives visant à atteindre la parité, sur un peu plus d’un million d’ingénieurs dans l’Hexagone, on ne compte que 24% de femmes. Une proportion qui stagne depuis près de 10 ans, selon l’Observatoire des ingénieurs et scientifiques de France.
La France n’est pas une bonne élève en Europe : selon des données récentes d’Eurostat, notre pays se classe au 19erang parmi les 27 pays de l’UE en termes de pourcentage de femmes travaillant comme scientifiques et ingénieures. La cause de ce déséquilibre n’est pas à chercher du côté de la biologie. En effet, selon une étude de Pauline Martinot, doctorante en neurosciences à l’Université Paris Cité, parue en juin 2025 dans la revue Nature, à l’entrée au CP, les résultats des filles en mathématiques sont identiques à ceux des garçons. Des recherches antérieures confirment d’ailleurs que les jeunes enfants présentent les mêmes compétences mathématiques de base. Mais quelques mois seulement après la rentrée des classes, un écart en faveur des garçons se creuse.
Enquête et témoignages pour comprendre la persistance de cette inégalité profonde.
Diabolisation de la femme cérébrale
Cette tendance à faire des sciences une spécialité plus masculine est surtout le résultat d’une construction sociale qui tend à assimiler la carrière scientifique à l’image de la réussite professionnelle, laquelle demeure l’apanage des hommes, estime la sociologue Marianne Blanchard.
Cette chercheuse à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès cherche à comprendre les origines de cette situation pour y remédier. Selon elle, le poids des stéréotypes demeure très fort : « Il existe tout un imaginaire qui associe les scientifiques à des hommes en blouse blanche. » Et d’ajouter :
De nombreux travaux montrent le manque de rôle modèle féminin en la matière. La seule que l’on présente généralement, c’est Marie Curie qui a reçu deux prix Nobel. Ce profil paraît inaccessible pour beaucoup de jeunes femmes. On constate que mêmes celles qui s’orientent vers des prépas scientifiques postulent moins à certaines écoles prestigieuses.
Alors les femmes s’imposeraient-elles elles-mêmes des barrières ? « Elles se censurent parce qu’elles sont censurées. Leur entourage et la société les attendent moins souvent dans les filières scientifiques », rétorque la sociologue. Claire Chambolle, professeure d’économie à l’École Polytechnique, va plus loin :
Le poids culturel est énorme en France, c’est historique. Les femmes ont longtemps été responsables du foyer et les hommes ont instauré une diabolisation de la femme cérébrale. Les petites filles grandissent avec ça dans leur tête, cette image très forte va les décourager.
Compétition en prépa
Pour contrebalancer ce poids culturel, il faut s’attaquer au sujet dès l’école primaire, affirme Marie Bresson, censeur des classes préparatoires à l’Institution Sainte-Marie à Antony (Hauts de-Seine) et ancienne directrice de la diversité à l’École Polytechnique. « Les parents et les professeurs doivent pousser les filles à faire des maths tout au long de leur scolarité ». D’autant que d’autres freins s’ajoutent au fil des ans : « En classe prépa, constate Marie Bresson, c’est un âge compliqué, les filles n’aiment pas être en compétition avec des garçons, elles ont moins confiance en elles qu’eux et le rapport de séduction biaise les choses ».
Lorsqu’on les interroge sur leur rapport aux maths dans l’enfance et sur ce qui les a influencées dans leur orientation, les femmes ingénieures confirment ces pistes. À l’image de Coline, directrice générale d’une société de conseil en monétique. Poussée par ses parents à faire des maths, encouragée par des « supers profs » qui lui donnaient des exercices supplémentaires, elle n’a pourtant pas visé les prépas les plus sélectives.
« Trop de compétition me faisait peur, Je n’aimais pas l’idée qu’il n’y ait pas d’entraide, explique cette dirigeante de 46 ans. En prépa, cela ne se passait pas toujours bien avec les élèves garçons. Je ne me sentais pas toujours à l’égal, pas à l’aise. Mais fallait pas m’emmerder, j’ai beaucoup de caractère ! ». Aujourd’hui, l’entreprise qu’elle dirige fonctionne sous la forme d’une coopérative dans laquelle femmes et hommes perçoivent le même salaire. « Cela a beaucoup de sens pour moi », précise Coline.
Un faible goût pour la compétition, mais un fort caractère : le portrait-robot des filles de sa promotion en école d’ingénieurs, retrace Carine, désormais « Global tech customer success director » au sein d’un grand groupe de vins et spiritueux et mère de trois enfants.
Il y a un problème de confiance chez les jeunes femmes, elles se mettent des barrières et je ne sais pas pourquoi, constate cette dirigeante qui vit à Paris. Je constate aussi que parmi mes copains de promo, les femmes aiment trouver du sens dans leur travail, comme moi. Elles ont des postes dans les RH ou aiment se mettre à la place du client. Les hommes, eux, veulent avant tout gagner de l’argent.
Vouloir être utile, aider… C’est une motivation que l’on retrouve souvent parmi les profils de femmes ingénieures, observe Marie Bresson, l’ex directrice de la diversité de l’École Polytechnique. « À l’X, elles se dirigent souvent vers les sciences de la vie ou l’économie, des matières ayant du sens. Et elles ne choisissent pas des sciences trop dures. »
Incitation dès le plus jeune âge
Certaines n’ont jamais douté de leur valeur, bénéficiant d’une solide confiance en elles dès le plus jeune âge, grâce à l’éducation de leurs parents. C’est le cas d’Alice*, 26 ans, ingénieure dans un groupe d’aéronautique. « Je n’ai jamais été élevée comme une fille, j’étais à égalité avec mon frère, je faisais ce que je voulais. Notre éducation n’était pas genrée. » Elle aussi a été encouragée par « une super prof de maths », poussée vers l’excellence au point d’intégrer HEC avant de poursuivre son parcours en école d’ingénieurs dans l’aéronautique.
La compétition ne me faisait pas peur, j’étais la seule femme de ma classe, assume Alice. Et j’ai fait cette école car je voulais servir l’industrie du pays, étant moi-même un pur produit de l’école française.
Afin de laisser la liberté aux femmes de faire leurs propres choix, sans se restreindre, il faudrait commencer par les inciter très tôt à se lancer dans des carrières scientifiques. Sur ce terrain, Marie Bresson remarque que les choses sont en train de changer. « Les parents sont plus sensibilisés et davantage convaincus qu’il faut pousser les filles à faire des maths dès le plus jeune âge. Cela prendra un peu de temps. Mais l’exemple du Maroc montre que cela peut bouger », veut croire la censeur des classes prépa de l’Institution Sainte-Marie à Antony. Les pays du Maghreb, où les mathématiques constituent une discipline reine pour emprunter l’ascenseur social, fournissent en effet un motif d’espoir : au Maroc, la part de femmes ingénieurs est de 40%, tandis que l’Algérie a presque atteint la parité avec 48,5% de diplômées dans ce domaine.
*Le prénom a été modifié car elle souhaite rester anonyme
Ces articles pourraient aussi vous intéresser :