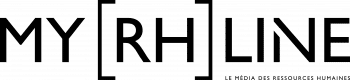Si les signes de désengagement sont de plus en plus visibles, certaines causes restent encore sous-estimées. Parmi elles : les modes de prise de décision en entreprise. Souvent centralisées et descendantes, les décisions restent à distance des réalités du terrain. Cette logique limite l’appropriation collective et, par ricochet, l’engagement des équipes. À l’inverse, lorsqu’elles sont construites avec les acteurs concernés, les décisions peuvent devenir un véritable levier de mobilisation.
Mais comment structurer une décision participative sans chaos organisationnel ? Quels leviers activer quand on est manager en prise directe avec le terrain ? Et quel rôle peut jouer la DRH dans cette dynamique de responsabilisation ?

Pour y répondre, myRHline a pu s’entretenir avec Lorraine Margherita, consultante Awair, conférencière et auteure d’un ouvrage sur la prise de décision partagée au sein des entreprises.
Quand la prise de décision devient un facteur de désengagement
Longtemps, les entreprises ont traité la prise de décision comme un acte de pilotage, centralisé et peu interrogé. Pourtant, dans les faits, ce mode de fonctionnement entraîne une mise à distance progressive des équipes. Conséquences ? Puisqu’ elles ne sont ni consultées ni vraiment informées, elles finissent par se désengager. (Sur une thématique similaire : Engagement collaborateur, les bonnes pratiques.)
Et pour cause : dans bien des cas, la décision descend, mais n’est jamais remise en question et, bien entendu, ne remonte jamais. Les décisions tombent, sans lien tangible avec les réalités du terrain.
Dans cette configuration, les collaborateurs sont alors censés appliquer ce qu’ils n’ont pas contribué à penser. Ce qui contribue à créer une certaine distance, et entraîne une perte de sens dans les projets d’une part, et un sentiment collectif d’inefficacité d’autre part.
Prise de décision participative : principes clés
Face à ces enjeux, certaines organisations choisissent une autre voie. Leur postulat : mieux décider, c’est décider à plusieurs. Bien entendu, il ne s’agit pas de faire voter tout le monde sur tout, mais plutôt de transformer la prise de décision en acte collectif, structuré et responsable. Cette démarche participative s’appuie sur trois piliers.
D’abord, écouter les perceptions. Cela suppose notamment d’ouvrir un espace d’expression réel, où chacun peut partager ses objections, doutes ou alternatives, mais aussi ses contributions ou propositions. Ensuite, aligner la décision sur un but commun. Pas un simple objectif opérationnel, mais une finalité partagée qui justifie les arbitrages. Enfin, poser un cadre :
- qui décide ?
- dans quelles limites ?
- avec quels moyens ?
- quelles conséquences ?
Lorsqu’on articule ces trois éléments, la décision devient un levier d’engagement. Elle n’est plus subie, mais portée. Elle devient dynamique.
En effet, chacun comprend pourquoi elle est prise, en quoi elle est utile, et comment il peut y contribuer. Loin d’alourdir les processus, ce mode de fonctionnement fluidifie l’exécution. Il renforce la cohérence, accélère l’adhésion et réduit la barrière entre réflexion et mise en œuvre.
Managers : par où commencer ? Le 3 + 1 de Lorraine Margherita
En pratique, il n’est pas toujours nécessaire de tout repenser. Lorraine Margherita partage 3 + 1 leviers activables sans bouleverser la structure.
- Premier levier : créer un espace de dialogue authentique avec les équipes. Cela suppose d’aller au-delà des entretiens formels ou de l’écoute symbolique. Il s’agit de comprendre les réalités de terrain, les points de friction, les irritants concrets, le vécu et les compétences du quotidien.
- Deuxième levier : rendre visibles les orientations et les articuler avec la culture de l’organisation. Pour quoi agit-on ? Dans quel cadre ? Avec quelles priorités ? En quoi cela correspond aux valeurs que l’on promeut ?
- Troisième levier : valoriser les réalisations. Cela ne demande ni outils ni budget, mais une posture. Citer les succès, reconnaître les compétences, prendre le temps de regarder ce qui fonctionne.
- Dernier levier : impliquer des alliés. Autrement dit, s’entourer de managers porteurs de la dynamique, capables de relayer l’énergie collective et de faire émerger les leaders de demain.
Quand on me demande par où commencer, il y a plus d’une dizaine de pistes possibles. Mais pour rester concrète, je partage toujours trois leviers facilement activables, même avec peu de moyens, et j’ajoute toujours un “plus un” : s’entourer d’alliés. Car ce sont les managers engagés, positifs, moteurs, qui feront vivre cette culture de la décision partagée. Ce sont eux qui vont engager les équipes dans une nouvelle dynamique.
Un rôle clé pour les RH
Le rôle de la DRH ne consiste pas à orchestrer toutes les décisions. Mais elle peut créer les conditions favorables à une culture décisionnelle plus engageante.
Certaines structures choisissent d’associer les équipes à la redéfinition de leurs valeurs. D’autres s’appuient sur une raison d’être clarifiée collectivement. D’autres encore amorcent le changement par les entretiens annuels, en introduisant des critères d’évaluation fondés sur la culture ou la contribution collective.
Il ne s’agit pas de plaquer un modèle de gouvernance, même si Lorraine en a identifié plus de 40. Mais de reconnaître que la responsabilisation des managers et l’autonomie des équipes ne peuvent pas s’épanouir dans un vide. Il faut une trajectoire, des référentiels, des points d’appui. Bref, un cadre à la fois sécurisant et dynamisant pour transformer les intentions en pratiques.
Et c’est précisément là que la fonction RH contribue de manière déterminante.