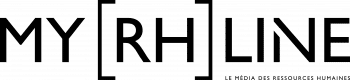La condamnation de plusieurs boulangers vendéens et parisiens pour avoir fait travailler leurs salariés un 1er mai a largement défrayé la chronique. Mais ce débat en fait apparaître un autre : est-il légitime en 2025 d’interdire à des salariés volontaires de travailler comme ils l’entendent en vertu de lois d’un autre temps ? Cette limite à la liberté individuelle de travailler est-elle encore acceptable ?
Je veux travailler le premier Mai !
L’affaire des boulangers ayant fait travailler leurs salariés un 1er mai est parfaitement typique du fatras réglementaire qui empoisonne la gestion des temps de travail en France. On y trouve une loi qui impose le 1er mai comme jour férié et chômé, mais prévoit une dérogation pour les établissements qui ne peuvent interrompre leur activité, sans fournir aucune liste des secteurs concernés. Tout est donc affaire d’interprétation, et les litiges se terminent régulièrement devant les tribunaux.
Ainsi, des secteurs vitaux comme la santé ou les transports peuvent faire travailler leurs agents. Pour les boulangers, il leur appartient d’apporter la preuve qu’ils ne peuvent interrompre leur activité, notamment s’ils fournissent des Ephad, des hôpitaux, ou des prisons. Et dans ce cas, ils peuvent demander à leurs salariés de travailler. Il s’agit donc d’un traitement au cas par cas, et on peut comprendre que certains aient du mal à se déterminer. En tout état de cause, la place laissée à l’interprétation présente de vrais risques. Le même flou règne dans la restauration, même si de très nombreux établissements ont encore ouvert le 1er mai dernier.
Quand l’inspection du travail ne laisse rien passer
5 boulangers Vendéens avaient été contrôlés par l’inspection du travail le 1er mai 2024 et ont fait l’objet de poursuites devant le tribunal de Roche-sur-Yon pour avoir fait travailler des salariés (volontaires) le jour férié. Ils risquaient une amende de 750 € par collaborateur et même 1500 € pour des apprentis mineurs. Une enseigne était passible d’une amende de 8 000 € à elle seule. Ils ont finalement été relaxés par le tribunal de police de La Roche-sur-Yon ce 25 avril. Mais le patron d’une enseigne de 3 boulangeries parisiennes, après avoir été convoqué au commissariat, est toujours sous la menace d’une amende de près de 80 000 euros pour les mêmes raisons pour un chiffre d’affaires sur la journée de … 8 000 €. Et celui-ci de s’étonner dans la presse de l’ouverture non verbalisée du Starbucks d’à côté le même jour !
Au nom d’une loi votée par le gouvernement de… Vichy
Le 1er mai a une très longue histoire en tant que journée de revendications et de manifestations, sans existence légale véritable. Ce n’est qu’en 1941 qu’une loi du gouvernement Pétain (loi Belin) va faire du 1er mai un jour férié et chômé. C’est donc le gouvernement de Vichy qui a instauré ce jour férié tel que nous le connaissons aujourd’hui avec une loi — qui on le voit dans l’affaire des boulangers — a des conséquences jusqu’à aujourd’hui à la fois sur le plan légal mais aussi, et de plus en plus, sur le plan social. Ainsi, la question peut légitimement se poser : une loi votée il y a 84 ans est-elle toujours adaptée au monde du travail de 2025 et aux attentes des salariés ?
Quand les syndicats et salariés divergent
La CGT a vivement réagi suite à la décision du Tribunal de la Roche-sur-Yon, craignant une extension non contrôlée de cette dérogation de fait à d’autres secteurs. Mais une dimension essentielle a été assez peu traitée : quid des salariés ?
Or, ceux-ci, interviewés par la presse régionale, sont nombreux à insister sur le fait qu’ils étaient volontaires et très motivés par le doublement de leur salaire sur cette journée.
Les salariés accordent-ils autant d’importance que les syndicats au respect pointilleux du caractère férié et chômé du 1er mai ? Cette situation rappelle la période où les syndicats s’opposaient à l’ouverture du dimanche d’enseignes de bricolage ou de parfumeries de la région parisienne. Et ce, alors même que les salariés concernés (sondages à l’appui) avaient confirmé leur souhait de maintenir cette organisation. Ils pouvaient en effet trouver un intérêt personnel à travailler le dimanche et à disposer de journées en semaine, pour leurs affaires personnelles par exemple.
Une limite à la liberté individuelle
Le cadre légal qui régit les temps de travail en France est d’une rigidité absolue et d’une complexité que plus personne ne maîtrise vraiment. La question qui se pose est de savoir si, au nom de cette usine à gaz réglementaire, on peut encore empêcher les salariés de travailler quand ils sont volontaires pour le faire et qu’ils y trouvent leur intérêt pour leur organisation personnelle et/ou pour des raisons financières.
La législation sur les temps de travail impose aux employeurs des limites en surabondance sur les :
- temps journaliers ;
- durées hebdomadaires ;
- temps de repos ;
- prises de congés, etc.
Or, toutes les enquêtes faites sur le sujet montrent que la première demande des salariés en matière de temps de travail est de bénéficier de plus de flexibilité. Mais cette souplesse attendue par les salariés se heurte de front à ces mêmes limites légales, y compris quand employeurs et employés sont d’accord sur les modalités.
Certains cadres aimeraient de temps en temps s’affranchir de la limite des 11 heures de repos parce que ça les arrange. Certains salariés voudraient travailler plus de 10 heures certains jours pour récupérer une demi-journée de temps en temps. D’autres pourraient déroger aux règles de repos hebdomadaire en raison de contraintes personnelles de garde d’enfants. Certains préfèreraient travailler un jour férié pour avoir un repos sur une date plus pratique pour eux. Mais ce faisant, ils mettent leur employeur dans une situation de risque juridique et financier. Et les sanctions administratives et judiciaires peuvent faire très mal.
Des garde-fous nécessaires, mais un carcan qui devient étouffant
Il n’est évidemment pas question d’autoriser tout et n’importe quoi en matière de temps de travail et un cadre légal reste un garde-fou nécessaire. Mais cette affaire montre qu’il est urgent de mettre un peu de souplesse et de discernement dans les réglementations pour prendre en compte des aspirations sociales et des changements de pratiques évidents. Les « acquis » du Front populaire ou des 30 glorieuses peuvent aussi être considérés comme des freins à la liberté individuelle par les salariés de 2025.